
Francis Bacon (1561-1626), scientifique, philosophe et homme d’État.
Dans le petit monde des vins nu, le vocabulaire utilisé pour les désigner glisse de vin nature à vin vivant, « La notion est plus inclusive que « nature » et « environnement », moins usée que « sauvage » et moins savante que « biodiversité » ou « non-humains ».
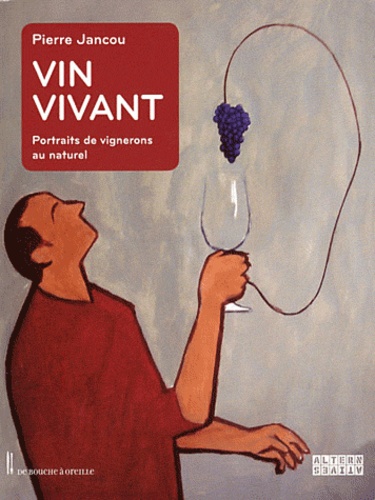
Le point sur le sujet : La nature est morte, vive le vivant ?
Plus l’horizon s’étrécit et plus la notion de vivant impose sa puissance, promesse de réenchantement des regards posés sur les milieux naturels, gage d’une pensée soucieuse de ce qui nous relie à tout ce qui croît et respire. Un vrai printemps pour l’esprit, dont le sacre apparent appelle cependant quelques pas de côté. Pour comprendre mot à mot, avec la philosophe Catherine Larrère, pourquoi le vivant semble avoir chassé la nature. Pour dévoiler, grâce à la sociologue Céline Lafontaine, les impensés d’une foule d’entités vivantes cloîtrées à l’ombre des labos. Pour inspirer, avec le biologiste Olivier Hamant, un nouveau modèle apte à nous faire traverser les turbulences à venir.
Par Sylvie Berthier et Valérie Péan
Un entretien avec Catherine Larrère, philosophe, professeure émérite à l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne
- Nombre de livres qui paraissent ces derniers temps dans le champ de l’écologie titrent sur le « vivant » et ont ainsi évacué le mot « nature ». Quelles sont les raisons de cette éviction ?
En France, il y a une tradition de méfiance à l’égard de la nature. Le mot est flou, polysémique ; surtout, il est à la fois descriptif (« ce qui est ») et normatif : il dirait « ce qui doit être », au nom d’un « ordre naturel ». On le soupçonne d’être porteur de représentations religieuses ou de conceptions romantiques, irrationnelles et sentimentales. Ce qui a servi en partie à attaquer les préoccupations écologiques lorsqu’elles ont commencé à prendre de l’importance. Puis, à partir des années 1990, c’est dans le champ même des mobilisations écologiques que la référence à la nature a été mise en question. Tout particulièrement par Bruno Latour et Philippe Descola.
- Que reprochent-ils à l’idée de nature ?
La nature que critiquent Latour et Descola, c’est la nature des Modernes, de Descartes et de son contemporain anglais F. Bacon1 : une nature mécanique qu’il convient de dominer, grâce à la science et à la technique mais, surtout, une nature posée comme extérieure à l’homme, dans une vision dualiste qui sépare nature et société, ou nature et culture, sauvage et domestique, l’objet et le sujet. Or, explique Latour dans « Nous n’avons jamais été modernes » (1991), ce « grand partage » ne partage rien : les distinctions entre les régions du savoir (sciences de la nature/sciences de la société ou de l’esprit) ne tiennent pas et, lorsqu’on croit pouvoir classer les êtres entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel ou social, les hybrides prolifèrent : le changement climatique, ensemble de phénomènes naturels qui sont les conséquences d’actions humaines, en est un exemple frappant. Il n’y aucun « donné » que l’on puisse dire naturel. La « nature », c’est en fait ce qui autorise les scientifiques à parler avec autorité, à imposer leurs vues.
La nature, vue comme une unité relevant d’une même explication, existant par elle-même et se distinguant des humains est, de plus, une idée typiquement occidentale, comme l’a montré P. Descola. Il nomme « naturalisme » cette façon de considérer, du côté physique, que le corps humain est organisé de la même façon que les autres êtres – ce qu’il appelle la continuité physique des extériorités – mais que l’homme se singularise de tous les autres organismes vivants par son intériorité (l’esprit). C’est l’exact inverse de l’animisme, selon lequel une plante, un animal, un humain diffèrent par leur apparence mais sont les mêmes du point de vue de leur intériorité. Car, dans le reste du monde, effectivement, d’autres façons existent de regrouper les existants, d’autres « ontologies » conduisent à d’autres « écologies », d’autres regroupements d’« humains et de non-humains » . 2
- Par quel mot Descola et Latour remplacent-ils alors celui de nature ?
La suite ICI

Le « vivant », un concept qui gagne en popularité dans la philosophie et les combats écologiques ICI
La notion est plus inclusive que « nature » et « environnement », moins usée que « sauvage » et moins savante que « biodiversité » ou « non-humains ».
Par Nicolas Truong
Histoire d’une notion. Les mots font ou défont les choses. Et les concepts, écrit le philosophe Baptiste Morizot dans le sillage de Gilles Deleuze, permettent même de « résister au chaos ». Lorsqu’ils se répandent dans l’espace public, ils deviennent les balises du basculement du monde et les marqueurs du changement des temps. Ainsi en va-t-il de la notion de « vivant », qui s’est largement imposée dans la pensée de l’écologie, et plus largement auprès de ceux qui cherchent à lutter contre la dévastation planétaire, attestée par les rapports scientifiques de plus en plus alarmants. En effet, « la crise écologique actuelle est une crise de nos relations au vivant », assure Baptiste Morizot, qui a donné à cette notion son actuelle dimension. « C’est un concept qui met l’accent sur nos interdépendances, et qui permet de travailler pour le bénéfice de nos relations avec les écosystèmes, sans opposer a priori et toujours les intérêts des humains et ceux de la “nature” », poursuit-il dans un entretien au Monde.
« Vivant » s’oppose tout d’abord à la mort, à la disparition d’une partie de la biodiversité qui prend la forme d’une « sixième extinction ». Dans l’insistance sur le vivant, « il y a une impulsion, sinon une pulsion de vie opposée à la pulsion de mort qui abîme les psychismes (écopsychologique), épuise les ressources humaines (burn-out) et naturelles (extractivisme), dans le mouvement morbide du nécrocapitalisme », analyse le philosophe Jean-Philippe Pierron.
« C’est la catastrophe en cours qui nous fait vraiment entrer dans le moment du vivant », explique le philosophe Frédéric Worms, directeur adjoint de l’Ecole normale supérieure. Mais qu’est-ce que le vivant ? « C’est l’ensemble des forces qui résistent à la mort », dit-il, en paraphrasant la célèbre formule du médecin anatomiste Marie François-Xavier Bichat (1771-1802) à propos de la vie. Sans compter qu’il y a quelque chose de performatif dans le vivant, une invitation à la résistance, voire une incitation à la métamorphose et à la renaissance.
« Vivant » permet de sortir du dualisme entre la nature et la culture. Pour les lecteurs de l’anthropologue Philippe Descola et du philosophe Bruno Latour, c’est désormais un acquis : nous sommes sortis du grand partage entre l’homme et le monde. La nature n’est plus un décor, un réservoir de richesses, une aire de repos ou un terrain de jeu. Avec ces nouvelles ontologies qui ne séparent plus la nature de la culture, les « non-humains » (plantes, animaux, fleuves, etc.) ne sont plus des choses ou des objets, mais des êtres qui importent, et doivent être mieux pris en compte par le politique, comme par le droit.
Le terme de « vivant » est plus inclusif et englobant. Il permet de rompre avec « l’environnement », « le sauvage » ou « la nature » dont l’usage suppose une extériorité de l’homme par rapport à son écosystème. Pour beaucoup, il serait également moins anthropocentrique que le terme de « non-humains » – qui suppose à nouveau une séparation entre deux entités. C’est pourquoi il est en train de prendre de l’ampleur dans le monde des idées.
« Nouveau regard sur le monde »
L’emploi de ce concept nous offre « un nouveau regard sur le monde, auquel nous appartenons aussi », témoigne Laurent Tillon, biologiste et ingénieur forestier à l’Office national des forêts qui, dans Etre un chêne (Actes Sud, 230 pages, 22 euros), raconte comment les arbres ont une histoire, à travers celle de « Quercus », un chêne sessile âgé de 240 ans qu’il connaît depuis l’adolescence : « Avec le terme vivant, on se sent appartenir à une même communauté. Quand je visite Quercus, je suis autant présent que n’importe quel autre vivant que je côtoie : mon arbre Quercus, le hêtre voisin, le pic dans l’arbre d’à côté, la mésange qui vient par curiosité, et le chevreuil qui s’interroge depuis quelque temps de ma présence si tôt en forêt en ce moment ».
Ce changement de paradigme conduit ainsi à une éthique, mais également à une politique du vivant. « Construire une cosmopolitique du vivant est le défi de notre époque », lance l’économiste Felwine Sarr. « La crise actuelle nous rappelle l’importance d’une “vital-démocratie” », assure Frédéric Worms. Après avoir théorisé les différentes « manières d’être vivant », Baptiste Morizot esquisse aujourd’hui les contours d’une « éthopolitique », afin de « restituer aux vivants les puissances d’agir qui sont les leurs, pour faire face avec nous aux métamorphoses environnementales contemporaines induites par le changement climatique ». L’éthopolitique donc, contre la « nécropolitique », cette soumission du vivant au pouvoir de la mort analysée par l’historien Achille Mbembe.

« Le “vivant” n’est pas un slogan, c’est une carte pour s’orienter » ICI
Le philosophe Baptiste Morizot précise la signification et la portée d’un concept « qui déplace la focale de notre attention collective vers nos interdépendances » avec les autres vivants, au moment où celui-ci est largement repris, mais parfois aussi critiqué.
Propos recueillis par Nicolas Truong
Publié le 22 septembre 2021
Maître de conférences en philosophie à l’université d’Aix-Marseille, Baptiste Morizot a notamment déployé le concept de « vivant » dans Manières d’être vivant : enquêtes sur la vie à travers nous (Actes Sud, 2020) et Raviver les braises du vivant. Un front commun (Actes Sud et Wildproject), et élaboré son « éthopolitque » dans Le Cri de Gaïa. Penser la Terre avec Bruno Latour (sous la direction de Frédéric Aït-Touati et Emanuele Coccia, La Découverte, 2020).
- Le concept de « vivant » que vous avez forgé est largement utilisé par des activistes, des associations ou même des institutions qui veulent lutter contre le réchauffement climatique et l’érosion de la biodiversité. En quoi est-il philosophiquement et politiquement important de changer de terme ?
Baptiste Morizot.- D’abord, il est important de rappeler que ce n’est pas un mot d’ordre ni un slogan : c’est un concept, donc une carte pour s’orienter, utile dans certains cas, inutile dans d’autres. Il n’a jamais visé selon moi à récuser les autres termes, mais à enrichir et pluraliser le paysage conceptuel et l’arsenal des idées.
Il faut se souvenir que porter ce concept n’a pas pour but d’interdire le mot « nature », mais de critiquer et conscientiser ses usages inquestionnés. Il sert à multiplier les approches, pour lutter contre l’hégémonie culturelle de l’idée de « nature » avec ses impasses – idée qui est toujours dominante dans notre héritage. Il n’a donc pas pour vocation de recréer un nouveau monopole à la place, mais de nous donner de l’air, et des outils pour mieux penser et agir.
Penser avec cette idée de « vivant » n’oppose plus nature et culture, puisque la culture est une manifestation du vivant dans l’humain, une faculté façonnée par l’évolution du vivant
Sa première force, en situation de crise écologique, c’est qu’il met la focale sur ces entités du monde qui sont concernées par leur existence, l’ensemble des vivants de la biosphère. Il n’y a pas à « sauver » le climat, il ne craint rien : ce sont les vivants qui doivent être protégés des dérèglements du climat, humains compris, puisque nous sommes interdépendants.
Sa seconde force, c’est que par l’usage du singulier, en parlant du vivant et pas seulement « des » vivants, il englobe non seulement les organismes et les espèces dans leur multiplicité, mais aussi les forces évolutionnaires anciennes qui les façonnent, et les dynamiques écologiques qui les tissent ensemble dans le présent.
Par là il se rend capable de saisir le « tissu » du vivant dans ses interdépendances, et le « fleuve » du vivant dans sa continuité depuis l’apparition de la vie sur Terre. Or ce sont ce tissage et ces dynamiques qui rendent la Terre habitable pour nous et pour les autres, et on comprend par là que ce sont elles qu’il faut défendre, et dont il faut prendre soin, et pas seulement de chaque espèce séparée comme si elle était posée là sur un décor.
Sa troisième force, la plus évidente, c’est qu’il échappe spontanément aux dualismes hiérarchiques de la modernité, qui opposent nature et société, environnement et humain. Ce concept permet, par la force de la langue elle-même, de ne plus opposer humain et nature, puisque par définition, nous en sommes, des « vivants », nous sommes embarqués avec tout le vivant pensé comme aventure biotique, nous sommes tramés aux vivants d’un point de vue écologique.
Nous partageons avec eux une ascendance commune, qui se manifeste dans la totalité de notre être. En un mot, c’est un concept qui déplace la focale de notre attention collective vers nos interdépendances – et qui permet par là de travailler pour le bien de nos relations avec les écosystèmes, sans opposer toujours a priori les intérêts des humains et ceux de la « nature ». Politiquement, sur le terrain, cela permet d’imaginer des fronts communs parfois libérateurs.
Voilà : c’est un mot qui respire spontanément en dehors du dualisme. Par exemple, penser avec cette idée de « vivant » n’oppose plus nature et culture, puisque la culture est une manifestation du vivant dans l’humain, une faculté façonnée par l’évolution du vivant. Ils ne sont pas intrinsèquement opposés : on peut imaginer favoriser une culture du vivant, de la même manière que la modernité s’est construite sur une culture qui l’a minorisé ou méprisé.
- De quelle manière cette notion peut-elle échapper à l’antimodernisme et l’antihumanisme ?
Ce concept ne sert pas à écarter ou rabaisser l’humain, au contraire, il sert à le penser de manière plus juste, et donc à le défendre mieux. Les mots « biodiversité » ou « environnement » ne nous incluent pas : ce sont des concepts qui réactivent l’extériorité fondatrice de l’humain envers son propre tissage.
Ce mot devient vide de sens lorsqu’il sert seulement à remplacer artificiellement le mot « nature » sans changer la philosophie du propos (c’est-à-dire la manière dualiste de penser, ou l’idée d’une mère nature harmonieuse et bienveillante)
Le concept de vivant sert à ça au fond : il permet de localiser ce dont on parle hors de nous et en nous, et d’opérer ce faisant le geste philosophique le plus décisif à mon sens dans cette affaire - nous recomprendre, nous humains, comme des vivants. C’est ce que j’appelle la manière humaine d’être vivant. Elle n’a pas la rigidité d’une « nature humaine », mais elle ouvre néanmoins le champ de nos possibles. Et ces derniers sont tissés.
Nous sommes une forme de vie unique mais interdépendante (comme les abeilles sont une espèce unique et interdépendante). Le vivant, ce n’est pas une catégorie scientifique (l’ensemble des organismes), c’est un concept philosophique qui nomme notre relation à l’aventure de la vie sur Terre : c’est la communauté du monde à laquelle on appartient, c’est une vulnérabilité mutuelle, c’est une dimension de l’expérience humaine, et c’est une condition partagée, la condition vivante.
Avec ce concept, l’enjeu n’est donc pas de faire une classification biologique comme on en trouve dans les manuels de sciences naturelles, mais d’imaginer collectivement des transformations métaphysiques et anthropologiques, en tant que notre image du monde est toujours une image de nous.
Sur ce chemin, du point de vue pratique, on active un meilleur humanisme, on prend mieux soin des humains, parce qu’on comprend qu’il faut prendre soin de leurs interdépendances avec les autres vivants – ce sont elles qui rendent nos vies possibles et nos sociétés durables.
- Mais ce concept vivant est-il bien compris ? N’a-t-il pas tendance à être dilué ou instrumentalisé tant son usage se répand aujourd’hui ?
Il génère quelques dérives, comme tous les mots qui circulent vite. Selon moi, il doit être utilisé rigoureusement et avec justesse sous peine de perdre son sens et sa force. On voit aujourd’hui fleurir une profusion d’usages hyperboliques ou abusifs, qui créent une certaine lassitude autour de ce mot, et comme une irritation. C’est un effet de mode qui passera.
Par exemple, il devient vide de sens lorsqu’il sert seulement à remplacer artificiellement le mot « nature » sans changer la philosophie du propos (c’est-à-dire la manière dualiste de penser, ou l’idée d’une mère nature harmonieuse et bienveillante), parce qu’il est rabattu sur des notions et des imaginaires qu’il a pour vocation de dépasser.
Je suis aussi en désaccord avec ceux qui lui ajoutent des consonances mystiques, religieuses, ou New Age. On voit ce malentendu dans les usages qui mettent spontanément une majuscule à « vivant » : à mon sens, c’est une catastrophe philosophique, parce que c’est contradictoire avec le sens même du concept.
En effet, la majuscule sert dans la langue française à sacraliser quelque chose sous une forme qui met à distance, qui impose une éminence. Elle instaure une nouvelle transcendance, alors que justement le concept de « vivant » permet de parler de la biosphère dans sa pluralité diffuse, omniprésente, profane, mais d’en parler avec les égards ajustés : c’est-à-dire sans la désanimer, mais sans la suranimer non plus. Et sans sacraliser non plus chaque organisme, puisque le vivant vit chaque jour de s’entremanger, c’est la base des écosystèmes, et c’est ce qui rend possible leur épanouissement.
Le malentendu avec la majuscule, c’est qu’elle confère une aura de religiosité, avec toutes ses inerties, à la chose la plus immanente et quotidienne du monde – à la vie.
Enfin il y a ceux qui s’en emparent pour « greenwasher » leurs pratiques et continuer le « business as usual », l’exploitation aveugle et destructrice des écosystèmes : quant à eux, ils n’ont aucun scrupule à récupérer et dénaturer tout discours qui s’oppose à leurs intérêts.
C’est en partie pour faire barrage à ce kidnapping que j’ai écrit le livre Raviver les braises du vivant, et publié le texte accessible en ligne librement : « Nouer culture des luttes et culture du vivant. »
Concernant les limites et les points aveugles de ce concept, ils sont partout : il ne sert pas à tout, sinon il ne servirait à rien. Par exemple, concernant les problèmes de philosophie de la technique ou les questions d’énergie pour faire face à la crise écologique, ce concept n’est pas le plus opérationnel aujourd’hui, et tant mieux (trop embrasser, c’est mal étreindre). Et pour faire de l’astrophysique – n’en parlons pas. Ce n’est pas grave, c’est bien ainsi, les concepts servent aussi à ça : à ne pas servir, à reposer, comme dans la trousse à outils d’un cambrioleur, jusqu’au jour où ils ouvriront d’autres portes qui nous enfermaient.
Nicolas Truong




/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)