« Le baron Philippe est l’arrière-petit-fils de Nathaniel de Rothschild (branche anglaise). C’est lui qui acheta en 1853 la propriété de Mouton qui a fait de Philippe un vigneron prospère. Toujours fastueux, il nous invita à y passer trois jours.

Le château de Mouton – nom qui dérive, aime à dire son propriétaire, du vieux mot français « mothon », signifiant « petite colline » – est situé en plein cœur du Médoc, cette bande de terre à gauche de la Garonne d’où jaillissent les plus célèbres vins du monde. Nous y arrivâmes par un de ces jours glorieux de septembre, le soleil se couchant au ras des vignes tirées au cordeau, soignées comme un jardin à la française, qui enserrent le château. Autrefois, un chemin communal coupait le domaine. Le baron – ce qui n’est pas donné au commun des mortels – l’a racheté à la municipalité. Tout aujourd’hui est « d’un seul tenant » pour obéir à cette obsession des grandes familles rurales. Au centre, Petit-Mouton est une bâtisse romantique à véranda dont la laideur début de siècle se trouve cachée par la vigne vierge et des cèdres exubérants. Nous coucherons dans les communs, les anciennes granges de la ferme attenante somptueusement transformée ; l’un dans la « chambre chinoise », l’autre dans la « chambre aux singes » (1)
À peine sommes-nous descendus de voiture que Philippe de Rothschild nous convie à sa piscine, couverte et chauffée, où nous apprenons entre deux brasses le nom des autres invités, dont un membre du bureau politique du Parti communiste français : Louis Aragon, rencontré lors d’un précédant voyage… Nous reconnaîtra-t-il en ces lieux ?
Nous serons fixés le soir même, au dîner. En djellaba et mules de tapisserie, le baron accueille ses invités. Aragon fait son entrée le dernier, le regard bleu vacille un instant… dira, dira pas, Finalement il jette à l’un d’entre nous : « Celui-là, je le connais… » On passe à table, couverte de bouquets savamment dressées par une décoratrice florale préposée à cette tâche. À côté de chaque convive, le menu dont, pour votre édification nous citerons les vins : avec l’entrée, un cheval-blanc 1959, avec le rôti, mouton-rothschild 1949 et 1916 (celui-là, quel souvenir !) et, avec le dessert, yquem 1921.
La conversation se déroule de façon un peu chaotique parce qu’Aragon, qui se veut le centre d’intérêt principal de la soirée, devient sourd, ce qui oblige Philippe et ses invités à crier et rend difficile le dialogue. À cause de cette infirmité ou par choix délibéré, le poète est parfois absent, d’où une atmosphère un peu irréelle. À quelques traits, on voit cependant apparaître certaines réminiscences de son époque surréaliste : « est-ce que vous connaissez la talmouse ? » demande Aragon au passage d’un plat. (2) « Est-ce qu’on peut en emporter la peau pour faire une descente de lit ? » répond Rothschild sur le même ton guilleret. Aragon : « ce n’est pas un animal, c’est un plat. » « Qu’est-ce qu’il y a dedans ? » demandent les autres. « Vous le saurez en mangeant », conclut Aragon.
Peu avant le dessert, la conversation devient politique. À une allusion de Rothschild qui semble impliquer les communistes, Aragon lance superbe : « Tu ne connais pas la cause que je sers ! »
Il est ensuite, question de la dernière guerre. Le poète qui, avant qu’elle ne fût déclenchée, « conchiait l’armée française » dans un texte célèbre, évoque aujourd’hui ses souvenirs farfelus d’adjudant-médecin et de confident du colonel de son régiment ; « un officier très convenable » : « Au fond, j’aimais assez le milieu militaire. »
Comme dans bien des conversations mondaines, on saute les époques et l’on en vient à Malraux : Aragon raconte que Malraux, à la Libération, était persuadé qu’il le recherchait dans tout Paris avec un pistolet pour l’abattre. « Quand il était Ministre de la Culture, nous nous sommes vus souvent en secret, chez Gallimard. » Un silence, puis avec le sourire du mystificateur qu’Aragon redevient ou qu’il n’a jamais cessé d’être, il ajoute : « J’ai pu dissiper cet affreux malentendu… »
Autre histoire, celle de la visite de Brejnev à Paris : « J’ai eu avec lui un entretien particulier de vingt minutes. Les ambassadeurs, les membres du Bureau politique faisaient le pied de grue, dans les salons. Un camarade n’a pas supporté cet aparté et s’est précipité pour l’interrompre, c’était Jeannette Vermeersch. Brejnev lui a dit « Attends, camarade, je n’en ai pas fini avec Louis Aragon ! »
Après le dîner, nous passons au salon : celui de Petit-Mouton est Napoléon III. Rouge étouffant des rideaux, au sol un gigantesque tapis de la Savonnerie représente « Badinguet » et la reine Victoria, se donnant la main pour célébrer l’avènement du libre-échange et le traité de commerce franco-anglais. Aux murs, l’arrière-grand-père Nathaniel et Philippe en garçonnet. Aragon, assis dans un fauteuil crapaud contemple l’assistance et le décor et lance à Philippe : « Ça donne envie de jouer aux billes. » Suit un numéro où il est question de découvertes faites chez les antiquaires. Avec un soupir, le poète déclare : « c’est difficile de rivaliser avec toi. Je n’ai qu’un seul objet – une statuette de l’époque de Cromwell – qui m’a été donnée par une admiratrice. Je l’avais découverte dans une boutique, mais son prix dépassait mes possibilités. Un mois plus tard, je reçois une lettre avec la statue : « Maître, je n’avais pas compris qu’elle vous intéressait. Prenez-la ! »
La soirée terminée, nous regagnons nos chambres où nous retrouverons notre linge repassé, nos boutons recousus – et nos esprits. Où étions-nous ! Ailleurs », assurément. Mais n’est-ce pas toujours ainsi chez les Rothschild, et cela dès la naissance ? »
(1) la dénomination des chambres du château est fonction de leur décor : papier, tentures, mobilier;
(2) le sieur Poireau sait !
André Harris et Alain de Sédouy Les Patrons Seuil 1977
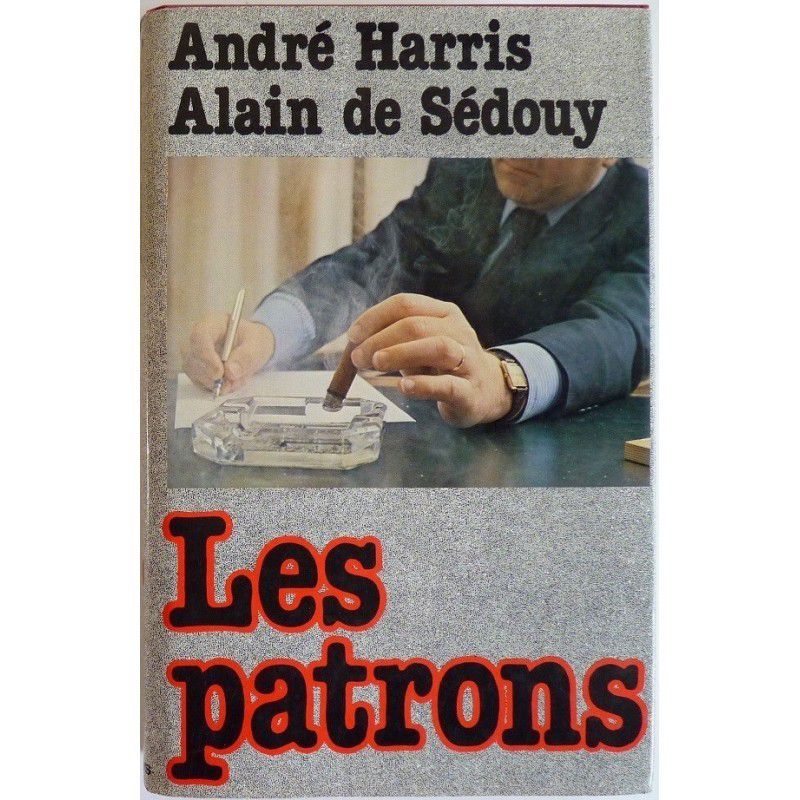
André Harris commence sa carrière comme journaliste à Europe 1 en 1960. Il rejoint l'ORTF en 1963 pour diriger le service politique du journal télévisé. Là, il rencontre Alain de Sédouy, son compère de toujours (on dira «Harris et Sédouy» comme Laurel et Hardy), avec lequel il conçoit un magazine baptisé Zoom. Le tandem bouillonne d'idées. Mais ces idées butent sur le conformisme ambiant. Nous sommes dans cette période pré-soixante-huitarde de la France qui s'ennuie, qui remâche l'histoire officielle, exalte une mythologie lénifiante de la France résistante. Les deux hommes rêvent de remuer le traitement de l'Histoire à la télévision. Ils veulent rompre avec son travers héroïsant. Ils travaillent sur une série qui raconterait l'histoire contemporaine aux français. Mais ils ont à peine lancé un épisode, Munich ou la paix pour cent ans, réalisé par Marcel Ophuls, que Mai 68 arrive. C'est là que Harris et Sédouy se font «virer à grands coups de pied dans le cul». «A l'époque, expliquait Harris à Libération en 1995, le pouvoir ne savait pas bien manipuler la télévision. Pour de Gaulle c'était une niaiserie moderne, peut-être n'avait-il pas entièrement tort d'ailleurs.»
Après son «éjection» de l'ORTF, la traversée du désert aurait pu être longue. Mais Harris n'est pas homme à scruter l'horizon en attendant les Tartares. Dès 1969, poursuivant l'obsession faulknérienne du «passé qui n'est pas passé», il entame l'écriture du Chagrin et la Pitié avec Marcel Ophuls, en Suisse. Ce documentaire, qui subvertit la version officielle de l'histoire de France sous l'Occupation, sort en salles en 1971. Il choque. «Pas tellement les résistants qui étaient bien placés pour savoir, disait Harris, mais plutôt ceux qui préféraient qu'un brouillard épais demeure sur cette période.» Le film ne passera à la télévision qu'en 1981, après l'élection de Mitterrand. Entretemps, il réalise d'autres oeuvres maîtresses comme le fameux Français, si vous saviez (1972), qui a scotché devant leur écran une génération de téléspectateurs fascinée par cette chronique sociale et historique, puis Pont de singes (1976) et les Enracinés (1981).





/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)