Je suis sûr et certain que vous ignorez où se situe Saint-Pierre-le-Moûtier…
C’est dans le Bourbonnais capitale du « bon pays entre Loire et l’Allier »…
2000 habitants
« Le 4 novembre 1422 le bailliage de Saint-Pierre rendit une sentence, contraignant les habitants de la terre de Poussery au finage de Montaron à assurer le guet et garde au château de Poussery, comme le demande le seigneur des lieux : Gaucher de Courvol. Ce bailliage rendit au fils de ce dernier : Philibert de Courvol, une autre sentence le 25 mars 1451, l'autorisant à faire passer le ruisseau des Ruaux, dans son pré de Chaulgy.
La ville est prise d'assaut, puis libérée par Jeanne d'Arc le 4 novembre 1429.

Elle fut chef-lieu de district de 1790 à 1795.
Au cours de la période révolutionnaire de la Convention nationale (1792-1795), la commune porta provisoirement les noms de Brutus-la-Vallée, de Brutus-le-Magnanime et de Brutus-le-Moutier.
La France profonde des terroirs, celle de nos ancêtres les Gaulois cher à notre petit Nicolas.
Résultats régionales Saint-Pierre-le-Moûtier (58240) – 2ième tour 2015
« Avec 2 030 habitants sur les 2 816 814 que l'on dénombre dans la future région Bourgogne, Franche-Comté, Saint-Pierre-le-Moûtier constitue un pays électoral difficile. François Patriat y avait arraché 35,91% des votes pour le premier tour des précédentes régionales. La liste portée par les Républicains était arrivée à la seconde place. Concernant le mouvement de Marine Le Pen, un votant sur 8 lui avait donné sa confiance. L'amplification de l'électorat du FN pourrait modifier l'équilibre des partis à Saint-Pierre-le-Moûtier ainsi que pour les résultats des régionales à Charrin.L'autre inconnue à prendre en compte reste indubitablement la participation qui, à 46,53% au premier tour se situait sous la participation enregistrée à l'échelle de la future région. Pour mémoire, les bureaux de vote à Saint-Pierre-le-Moûtier ont voté comme ceci lors des précédentes élections:
La suite ICI
Voici un beau COCORICO relaté dans le Bulletin Municipal d’août 1952.
« La réfection complète du clocher de l’église de Saint-Pierre-le-Moûtier par les ouvriers de l’entreprise Danois de Moulins est maintenant terminée. Avant d’enlever les échafaudages, il restait aux ouvriers un travail suprême à accomplir : hisser le nouveau coq tout là-haut, à la fine pointe du clocher.
Cette opération, extrêmement délicate, s’est déroulée le vendredi 22 août 1952, quelques minutes avant midi, et a revêtu un caractère quasi solennel. Lorsqu’on vit un homme dresser une grande échelle le long de la croix surmontant le clocher, la cité toute entière comprit que le grand moment était proche.
De nombreuses personnes se rassemblèrent sur la place du Marché, tandis que d’autres se postaient aux fenêtres des étages supérieurs ou aux lucarnes des greniers. Tenant le coq d’une main, un ouvrier monta lentement les échelons et parvint enfin à la pointe du clocher, dominant Saint-Pierre et ses environs d’une hauteur de 35 mètres. Un autre compagnon grimpa derrière le premier et tous les deux, à cheval sur la croix, points à peine perceptibles suspendus dans le vide, se mirent en devoir de fixer notre nouveau coq, dont le corps majestueux, resplendissant au soleil de midi, étant entouré d’un large ruban tricolore, symbole émouvant de la foi inébranlable de tout un peuple dans les destinées de la patrie.
Durant quelques minutes, il sembla que le rythme normal de la vie s’arrêtait dans toutes les artères de la ville.
Dans la campagne environnante, l’homme des champs, la main au-dessus des yeux, observait intensément, lui aussi, cette besogne religieuse. Un frémissement anxieux et admiratif parcourait toute la population dont les regards étaient rivés sur ces deux hommes qui, pareils aux héros antiques, exécutaient une tâche semblant être particulièrement réservé aux dieux. Soudain, ce fut l’instant solennel : le coq était placé sur son piédestal. Entourant le vieil emblème des Gaules d’un bras, les deux ouvriers, assis sur la croix, défiant le vertige et le vide, levèrent leurs casquettes en signe de victoire.
Alors, les cloches de notre vieille église médiévale s’ébranlèrent et sonnèrent à toute volée, portant aux cieux l’hymne d’allégresse de toute une ville, célébrant l’avènement du nouveau coq saint-pierrois, tandis que de vigoureux applaudissements montaient jusqu’à ces hommes audacieux qui venaient d’accomplir une si belle prouesse.
Et maintenant, salut à toi, fier coq gaulois restauré, qui présidera de nouveau aux évènements sombres ou glorieux de notre petite capitale du « bon pays entre Loire et Allier » ! Nous te saluons et nous te souhaitons un long règne tout en haut du clocher, toi que les soldats de Vercingétorix portaient comme un emblème sacré au plateau de Gergovie, et qui lutta avec l’énergie du désespoir dans les plaines de Lutèce, avec Camulogène contre les aigles romaines des légions de Labinus. »
Pourquoi place-t-on un coq sur les clochers ?

Dans la tradition chrétienne, un coq est souvent placé au sommet du clocher des églises.
Au Moyen-Age, l’oiseau est un symbole solaire car son chant annonce le lever du soleil.
Il est le prédicateur qui doit réveiller ceux qui sont endormis. C’est en ce sens que le pape Léon IV décida, à l’époque, que les clochers de chaque église devaient arborer une telle girouette.
L’Eglise voyait l’animal comme le Messie annonçant le passage des ténèbres à la lumière. Le plus ancien coq de clocher connu vieux de près d’un millénaire se trouve à Brescia (Italie).
L’oiseau sacré chez de nombreux peuples, n’est cependant présent que sur les églises occidentales. Il n’y en a pas sur celles situées en Orient.
« Nos ancêtres les Gaulois », une invention de la Renaissance !

Inventée sous la Renaissance, reprise par la Révolution française, brandie par Napoléon III, cette notion de « nos ancêtres les Gaulois » repose-t-elle sur un fait historique ou n'est-ce qu'un mythe révisionniste ? C'est au tour de Nicolas Sarkozy de se réfugier derrière cette filiation pour justifier l'assimilation. Nous avons voulu en savoir un peu plus en interrogeant deux grands spécialistes de la Gaule : l'historien Dominique Garcia, spécialiste de la Gaule préromaine, actuel président de l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), et l'archéologue Jean-Louis Brunaux, spécialiste de la civilisation gauloise. Ils ne sont pas toujours d'accord.
Le Point.fr : Quelle part de vérité dans cette assertion « Nos ancêtres les Gaulois » ?
Dominique Garcia : Dès que j'ai pris connaissance de l'affirmation de Nicolas Sarkozy, j'ai réagi aussitôt sur Twitter pour dire qu'il n'avait pas saisi ou pas compris. Certes, il se place dans la tradition voulant que les gens s'identifient à un passé. En revanche, imaginer qu'il y a une lignée de Français qui remonte aux Gaulois, ça, c'est une aberration.
Jean-Louis Brunaux : La revendication des Gaulois comme nos ancêtres est tardive dans notre histoire. Elle apparaît timidement à la Renaissance pour affirmer l'ancienneté de la France par rapport à l'Italie. C'est surtout ça, le but. Plus tard, cette revendication de la civilisation la plus ancienne entre les pays et les rois va s'exacerber jusqu'au XIXe. Être gaulois, ce n'est pas une identité, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Être gaulois, c'est habiter la Gaule, sachant que la Gaule est un véritable pays, un véritable espace politique. Forgé notamment par les druides, qui ont eu une influence vraiment importante. C'est un concept politique et social. Les Gaulois ne connaissent pas le droit du sang.
D. G. : Les identités, les nationalités ne sont pas des éléments figés. Elles sont construites. Ce que l'on appelle les Gaulois, en fin de compte, n'est qu'un puzzle de populations sur des territoires relativement vastes, qui sont identifiés comme Gaulois par des populations venues d'ailleurs, les Grecs, les Romains.
L'élite gauloise a-t-elle collaboré avec le pouvoir romain ?
J.-L. B. : Je ne sais même pas si on peut dire ça. En fait, ce sont les Gaulois qui sont à l'origine de leur propre colonisation. Du moins une partie d'entre eux, ceux du Massif central qui ont demandé à César d'intervenir. Une grande partie des forces gauloises l'ont aidé à conquérir la Gaule. Mais à vrai dire, la romanisation est beaucoup plus ancienne que la guerre des Gaules. Il existait une proximité avec le commerce romain, dès les années - 150, - 100. Des nobles gaulois ne voulaient pas perdre ce commerce romain et cherchaient même à l'amplifier. Toute la noblesse était du côté de César.
L'intégrale ICI

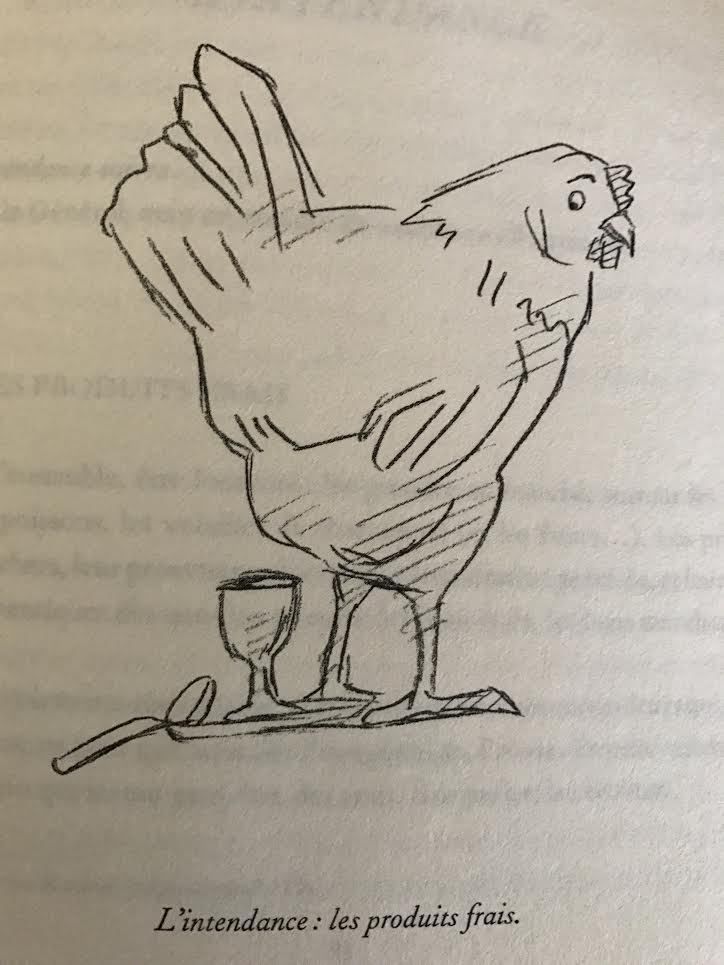
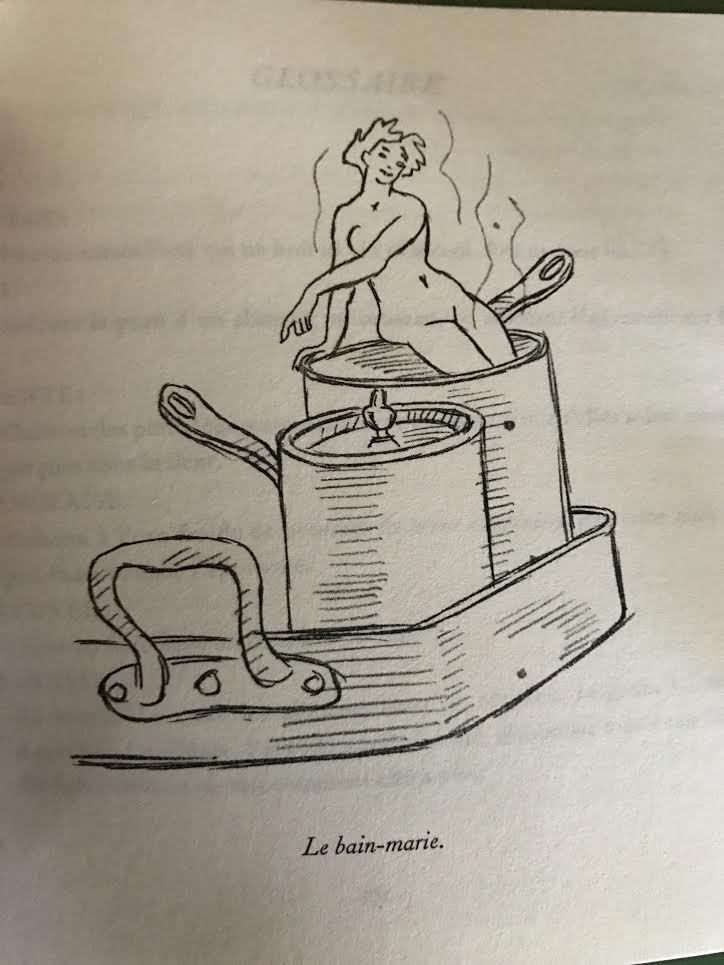



























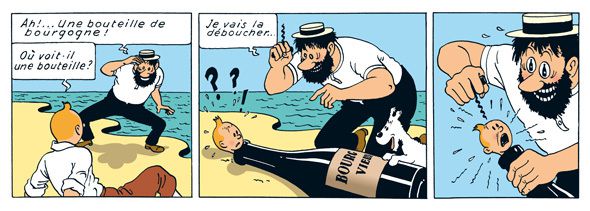























/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)