Je ne sais.
Peut-être parce que la France est la fille aînée de l’Église ?

En revanche, ce que je sais, c’est que certains sont célèbres, tels le saint-émilion et le saint-nectaire ; d’autres tels le saint félicien et le saint pourçain sont plus roturiers. Les saintes, elles, sont rares : le sainte-foy (500hl) à Bordeaux vin liquoreux confidentiel et le sainte-maure-de-Touraine qui est un fromage de chèvre assez connu (1140 T) mais comme toujours le masculin l’emporte sur le féminin puisque j’ai écrit le vin de sainte-foy et le fromage de sainte-maure.
En écriture inclusive je ne sais pas non plus ce que ça donne.
Plaisanterie mise à part, et même si après l’amphigouri je prends le risque de me voir taxé de pédanterie, permettez-moi de souligner que j’ai, pour une fois, parfaitement respecté l’antonomase des noms propres.
Cette figure de style, la seule vraie antonomase pour beaucoup de théoriciens, consiste à employer un nom propre pour signifier un nom commun. Les antonomases du nom propre, contenant le mot «saint» et qui, en se lexicalisant ont perdu leur majuscule : le saint-pierre poisson, le saint-nectaire fromage, le saint-émilion vin, la sainte-barbe cale à poudre, en sont la parfaite application. Ces antonomases sont parfois invariables : des saint-honoré, des saint-amour, des saint-marcellin.

Ne vous effrayez donc point, ne faites donc pas tout un fromage de ma pseudo-érudition, restez encore sur mes lignes.
Pour compléter cet amuse-bouche culturel destiné à relever le bas niveau de mes chroniques, un rapide survol de l’histoire du fromage s’impose et, même si ça choque notre chauvinisme, il est essentiellement transalpin.
Pline l’Ancien considère comme manifestation de la civilisation la capacité de transformer le lait en fromage : « il est surprenant de constater que certains peuples barbares qui vivent du lait, peuvent ignorer ou dédaigner, après tant de siècles, les qualités du fromage. » écrit-il.
« Dans la tradition antique, des représentations sociales qui, d’une manière presque automatique, associaient le fromage au monde pastoral et paysan, à la gastronomie du pauvre, vinrent s’ajouter des préjugés d’ordre culturel. » note Massimo Montanari.
« De Caton à Varron, de Columelle à Pline, des pages importantes des traités et de littératures antiques sont consacrés à l’élevage des moutons et des chèvres et à la préparation des fromages fabriqués avec leur lait. Dans la plupart de ces textes, le domaine d’utilisation des laitages a décidément une connotation sociale. Le passage où Columelle écrit que le fromage « sert non seulement à nourrir les paysans mais aussi à orner les tables élégantes » est significatif. Le message est clair : le fromage constitue un plat de résistance et, souvent, la source première d’approvisionnement des tables paysannes, alors que sur les tables riches, il apparaît comme un simple « embellissement », c’est-à-dire non comme un protagoniste ou comme un plat en soi, mais comme un ingrédient de mets plus élaborés. C’est justement sous cette forme – et seulement sous cette forme – que le fromage apparaît dans le traité De re coquinaria d’Apicius, le seul livre de recettes ce l’époque romaine qui soit parvenu jusqu’à nous. »
Cette image du fromage aliment typiquement paysan perdure tout au long du Moyen-Âge : « ce sont les pauvres qui s’en nourrissent, les pèlerins, les habitants des vallées alpines, pour qui les laitages sont une composante capitale du régime quotidien. Ce sont les clients des auberges qui s’en nourrissent. »
Le fromage est parfois utilisé à la cuisine des puissants comme ingrédients des sauces et des farces. Il est cependant rare de le voir servi à table, valorisé comme un produit en soi.
Mais, dans le premier traité européen spécifiquement consacré aux laitages, Summa lactticiriorum en 1477, le médecin italien, Pantaleone da Confienza, professeur à l’université de Turin, note « J’ai vu de mes yeux, rois, ducs, comtes, marquis, barons, nobles, marchands, plébéiens des deux sexes, se nourrir volontiers de fromage… il est évident que tous l’apprécient »
Massimo Montanari note à juste raison que « dans cette phrase se trouve formulé le renversement du préjugé séculaire : le fromage est bon pour tout le monde, nobles et plébéiens. »
« La modification des comportements à l’égard du fromage, qui est nettement perceptible au XIVe siècle, est aussi liée à l’apparition, au cours des deux siècles précédents, des premiers fromages de qualité », produits de grande réputation appréciés sur le marché et liés à des lieux d’origine déterminés ainsi que des techniques de fabrication précises. »
La fabuleuse histoire des fromages commençait.
Pantaleone da Confienza cite des fromages italiens d’excellence : « comme le pecorino ou le marzolino de Florence fabriqué en Toscane et en Romagne ; le piacentino de vache « appelé parmesan par certains », produit dans les régions de Milan, Pavie, Novare, Verceil, et les petits robiole de la région de Montferrat.
Il passe aussi aux fromages français parmi lesquels « il rappelle en particulier le craponne et le brie qui jouissait probablement d’une certaine renommée au niveau international puisqu’on le trouve aussi dans des livres de recettes italiens du XIVe siècle. »
Le plateau de fromages devenait un plat à part entière chez les particuliers et dans les restaurants…
Et puis à la bascule du milieu du XXe siècle la grande saignée de l’exode rural conjuguée avec la montée en puissance d’une puissante industrie laitière et fromagère, vont mettre en danger beaucoup de fromages traditionnels, soit par la disparition de la geste ancestrale, soit par l’appropriation indue de leur fabrication par les fromager industriels. En France, Lactalis détient en portefeuille un très lourd pourcentage des AOC fromagères.
De plus, le plateau de fromages ou le chariot de fromages ont souvent disparus des restaurants, même si, depuis quelques années, sous la pression de ceux qui se sont fait la bouche avec des assiettes de fromages dans les bars à vins, les fromages de caractère refont surface dans les restaurants à la mode.
« Le fromage est un aliment typiquement paysan, et quand il s’agit de donner à manger aux paysans, il leur est, pour ainsi dire administré d’office : au XIIIe siècle, les paysans qui dépendent du monastère de Saint Côme et Damien à Brescia, lorsqu’ils se rendent en ville pour déposer le paiement des locations, reçoivent tous un « goûter » composé de pain et de fromage. En revanche, l’agent qui supervise les travaux des vendanges, pour le compte des propriétaires, reçoit pain et viande. L’opposition ne saurait être plus claire : le fromage est la viande des paysans. »
Massimo Montanari « Entre la poire et le fromage »
Mais, revenons un instant, à ce qui fait un bon fromage, un bon produit : le temps, ce temps qui dit-on est de l’argent.
Comme nous vivons un Temps où chacun affirme ne plus avoir de temps, mettre ses pas dans les pas de ceux qui le prennent, c’est prendre le parti d’une forme de vie, celle qui respecte le rythme où les choses se font. Accélérer le temps, faire vite, à la va-vite, c’est ôter leur goût aux choses, les rendre bien souvent incolore, inodore et sans saveur.
Seule l’eau répondant à cette définition l’affadissement généralisé n’est porteur que de banalité. La différence alors ne se fait plus que sur des images : ainsi fleurissent sur les étiquettes des fermières, des Perrette et leur pot au lait mais adieu vaches, cochons, couvées, le camembert, le munster nous désespèrent et dans leur pochon plastifié nos fromages ne sont plus que des produits dérivés du lait, des subprimes fromagères !
Accusés : la GD et le HD avec la litanie des pousseurs de caddies qui consomment du prix. Dureté du temps certes mais il y aurait trop de facilité à s’en tenir qu’à une charge contre les Mammouths.
Le petit commerce spécialisé est-il toujours à la hauteur ?
Se différencie-t-il vraiment des rayons à la coupe des Grandes Surfaces ?
Ses fromages trop souvent ne sont que les cousins germains de ceux que l’on retrouve frigorifié dans les armoires de la GD.
Un produit de caractère a besoin d’être bien né et bien élevé pour tenir ses promesses dans notre assiette.
Désolé Emmanuel Besnier et Michel-Edouard Leclerc ont refusé de répondre

Connaissez-vous la marche en avant d’un fromage ?
Non, il ne s’agit pas du résistible coulage du camembert bien fait mais d’une stricte procédure règlementaire. Tout fromage remonté de la cave d’affinage pour la coupe ne doit jamais y redescendre. Ce qui signifie qu’il faut les stocker dans des frigos à froid sec de 4° avec, raffinement supplémentaire, qu’il ne faut pas mêler les petits fromages avec les gros, donc un grand frigo pour les gros et une petite armoire pour les petits. Et bien sûr on date les morceaux. Rien que des équipements à 3 francs six sous bien sûr. Tout va l’avenant : lave-mains à déclenchement au genou, poubelles blanches, plastique transparent, torchons pour essuyer la vaisselle mais papier jetable pour les mains, armoire de décontamination en fin de travail pour les couteaux, plus rien d’apparent ne doit rester tout doit être rangé dans des armoires. C’est effectivement un laboratoire.





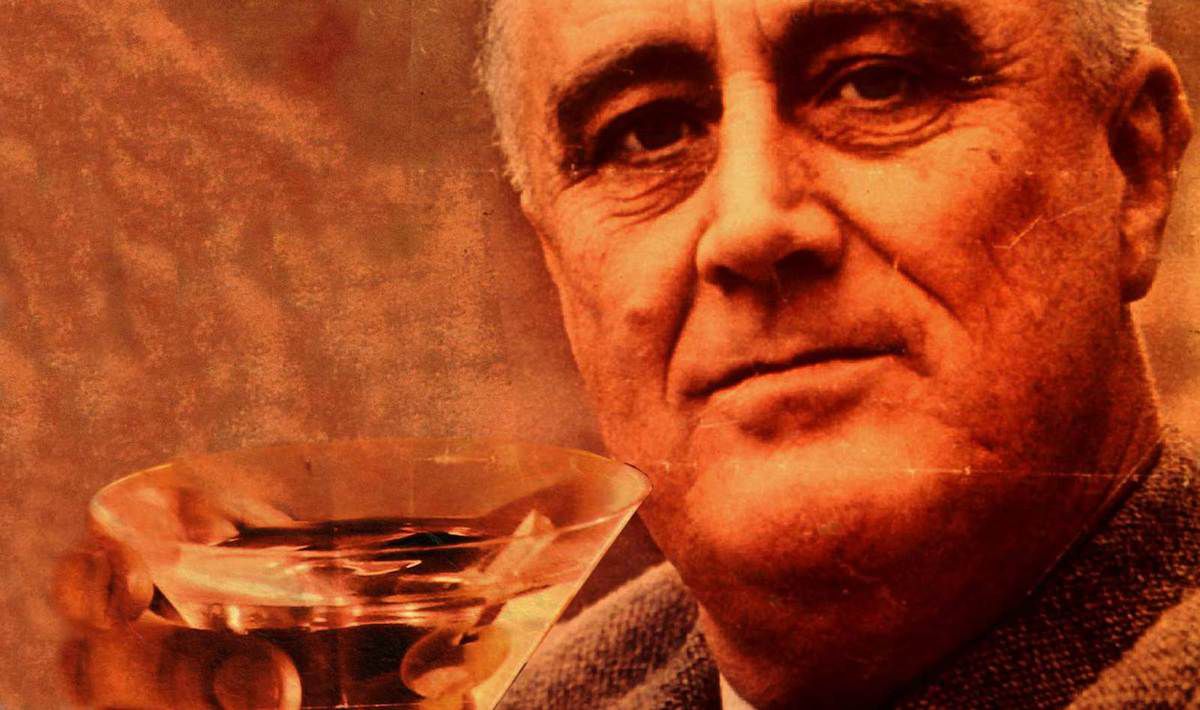






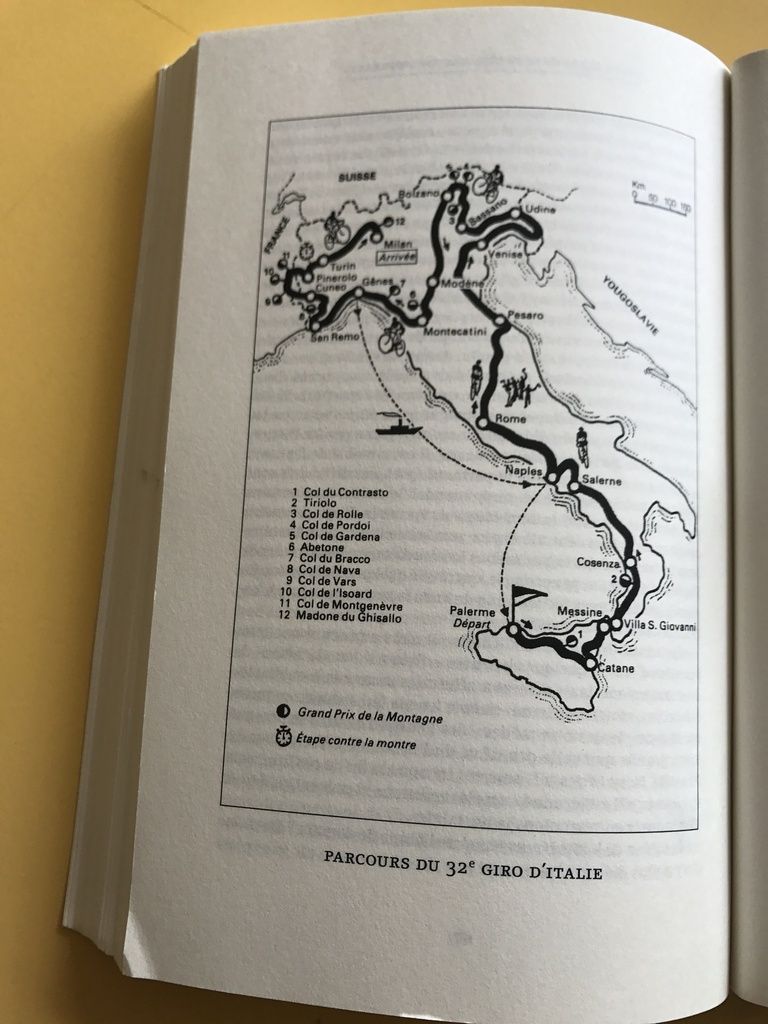




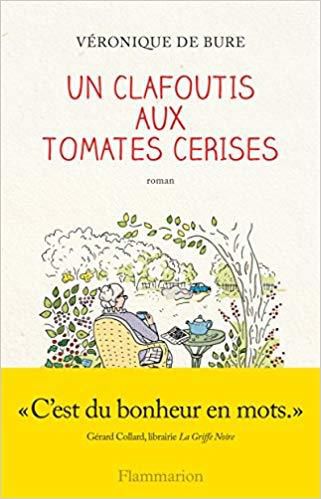


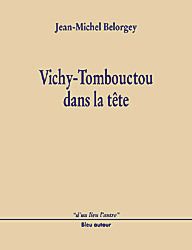

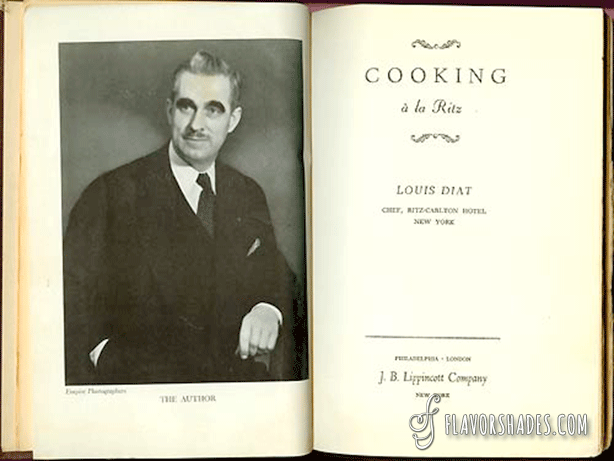
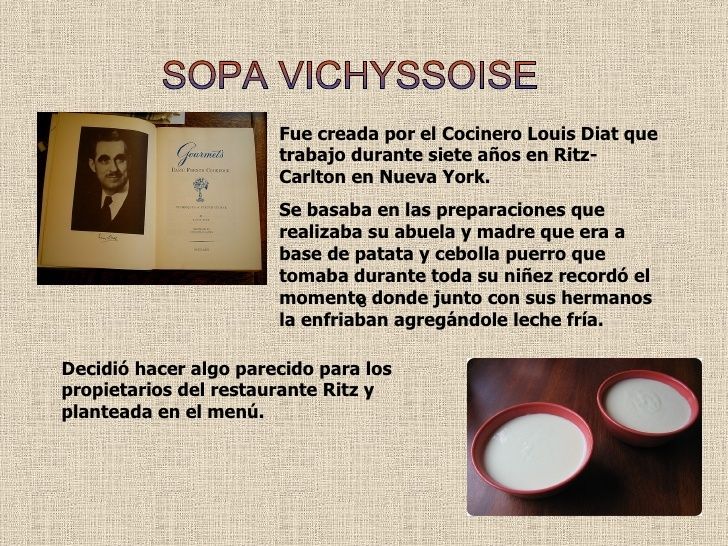

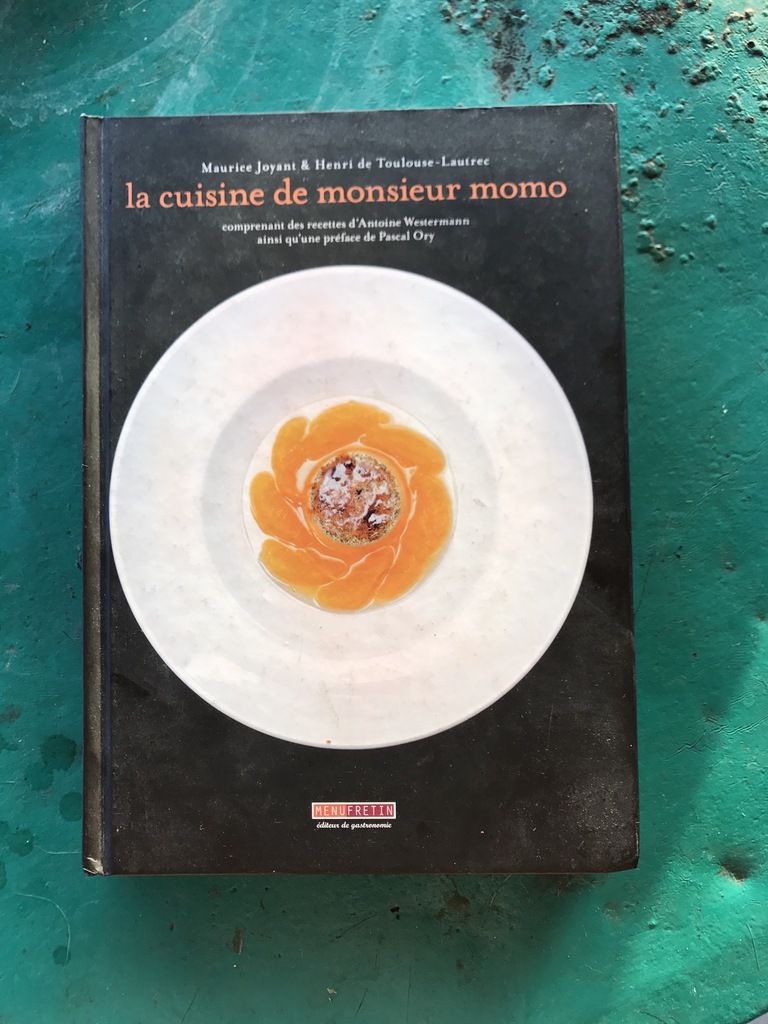






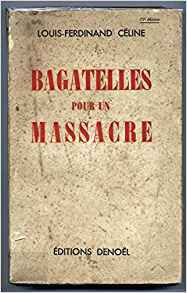





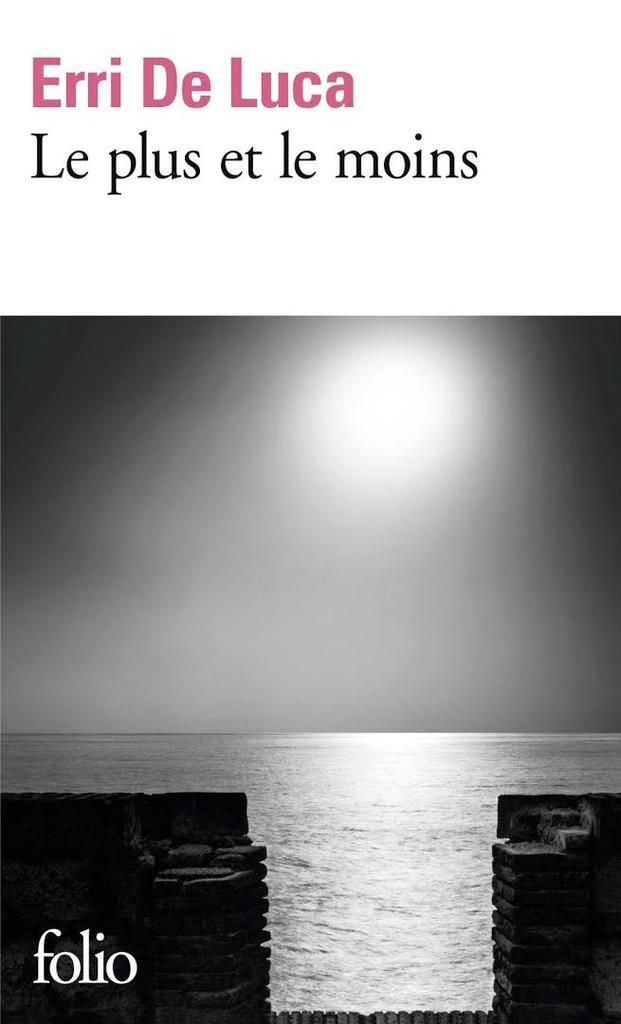
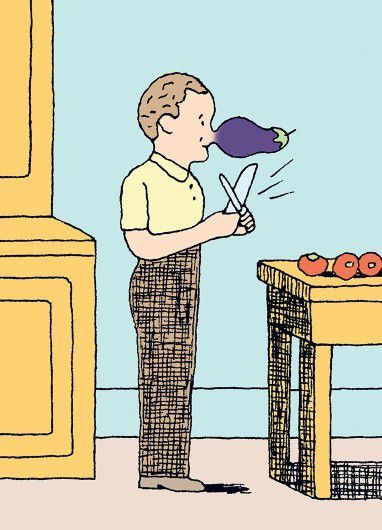


/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)