En notre beau pays François il va de soi que l’andouille est de Vire, de Guéméné, l’andouillette de Troyes, de Jargeau, la rosette et le Jésus de Lyon, les bêtises de Cambrai, les calissons d’Aix, la boulette d’Avesnes, le Brie de Meaux et de Melun, la carotte de Créances, le coco de Paimpol, l’agneau de Pauillac, du Mont-Saint-Michel, le Poulet de Loué, des Landes ou bien sûr de Bresse... etcétéra, etcétéra... Tout le monde sait à peu près ce que c’est mais quand à dire que c’est une AOC versus AOP, ou maintenant une IGP : Indication Géographique Protégée c’est une autre histoire...
Protégeons, protégeons, c’est doute un nouvel avatar du principe de précaution voilà t’y pas que c’est la ruée, nos produits régionaux courent presque tous se réfugier sous la bannière des IGP. Je rappelle que l’indication géographique protégée est un signe européen créé en 1992 qui assure au consommateur que le produit tire une ou plusieurs caractéristiques de son origine géographique. Pour les producteurs, l’enregistrement de l’IGP garantirait une protection de la dénomination revendiquée sur tout le territoire de l’Union européenne. Comme pour tous les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine, des contrôles réalisés par des organismes indépendants permettent de s’assurer du respect des conditions et de la zone de production.
Deux produits IGP ou en voie de l’être touchent de près à mes souvenirs d’enfance : le blé noir et la gâche et ça m’interroge !
J’aime cette expression « Je m’interroge... » depuis le jour où je l’ai entendue venant de la bouche à l’accent rocailleux de l’aveyronnais Mgr. Marty archevêque de Paris. Cet homme me plaisait car, contrairement à beaucoup de prélats de l’Eglise romaine il restait un homme simple. Je reviens donc à mon interrogation.
Pour la Farine de blé noir elle a obtenu l'Indication géographique protégée :
Le règlement européen enregistrant l’Indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne » a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 25 juin 2010.
Pour la Gâche elle vient d’entamer sa route vers l'IGP :
Le Comité national des indications géographiques protégées de l’INAO a approuvé le 2 juin 2010 le projet de cahier des charges « Gâche Vendéenne » dans la perspective de son enregistrement en IGP par la Commission européenne.
Moi, bien évidemment, pour cette dernière je n’ai rien contre même si le libellé du cahier des charges de la gâche vendéenne me laisse rêveur : « La gâche vendéenne est une viennoiserie de forme ovale, dorée et scarifiée sur le dessus. Elle doit au minimum peser 300 grammes et être présentée de manière individuelle sous sachet et non tranchée.
Sa composition riche en beurre, sucre et œufs est typique des gâteaux vendéens. La gâche vendéenne se différencie par la présence obligatoire de crème fraîche dans la recette. La fermentation longue de la pâte associée à la présence de crème fraîche contribue à l’obtention d’une mie serrée de couleur homogène et permet à la gâche vendéenne de développer une saveur lactée spécifique, où les arômes de crème fraîche et de beurre sont particulièrement marqués, avec une texture en bouche fondante. »
Si on avait dit à Valentine Pondevie la sœur de ma mémé Marie que sa gâche était une viennoiserie je ne suis pas sûr qu’elle eût goûté la plaisanterie. Pour moi c’est clair la seule gâche qui eut méritée d’être une IGP c’est la sienne car elle était la quintessence de la gâche vendéenne, inégalée, inégale, et d’ailleurs pour c’était la fouace, la gâche de Pâques. J’ai déjà chroniqué sur ce beau sujet et si vous voulez savoir ce qu’est la vraie gâche vendéenne allez vite sûr http://www.berthomeau.com/article-6279730.html
Sans être mauvaise langue, ce ne sont pas les boulangers du coin qui ont demandé l’IGP « Gâche Vendéenne » mais bien plutôt les fabricants qui travaillent pour la GD. Grand bien leur fasse mais leur gâche même tamponnée comme IGP n’est qu’un pâle ersatz de ce que fut la merveille de mon enfance. Mais foin de nostalgie, les affaires sont les affaires mais cette brave « gâche vendéenne » était-elle si menacée ? Si oui, par qui ? Qui donc sur le territoire de l’Union aurait été tenté de la copier pour inonder le marché ? Oui, ça m’interroge !
Pour le blé noir, plus exactement sa farine, je suis plus d’accord. En effet « la farine de blé noir de Bretagne se caractérise par une coloration importante. La Bretagne dispose d'un climat idéal pour la culture du blé noir dont l'exigence en eau est importante. Le blé noir est une plante avec un cycle végétatif très court (semis en mai-juin, récolte en septembre-octobre) adapté aux climats tempérés. De plus « L’obtention de la Farine de blé noir de Bretagne encore appelée « Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh » est réalisée selon une méthode traditionnelle. Après nettoyage, les graines sont broyées par un cylindre ou une meule.
La production de blé noir en Bretagne est connue depuis le 14ème siècle. Cette production a été développée comme première culture dans les marais nouvellement asséchés ou les terres défrichées. Très vite, la graine de blé noir a été transformée en farine. Le nombre de moulins transformant la graine de blé noir en farine a toujours été important en Bretagne. Il s’élève encore aujourd’hui à une trentaine. »
Reste ensuite la question des galettes de blé noir où là c’est globalement la catata : la crêperie dite bretonne est trop souvent un fast-food avec décor ad hoc, mobilier rustique, sono biniou, où les galettes ne valent guère mieux que le Big Mac de Mac Do et ne parlons-pas de la bolée de cidre genre le gaz part. Bref, autour de la gare Montparnasse elles sont touche à touche et vraiment ce n’est pas la joie. La complète est d’une tristesse à pousser au suicide un breton...
Que voulez-vous, quand comme moi on a été nourri le vendredi par les galettes de blé noir de ma mémé Marie faut pas lésiner sur la qualité. Comme je chronique depuis si longtemps je ne sais plus si un jour je vous ai parlé des galettes de blé noir de ma mémé Marie. Peut-être que oui il y a une chronique dans mon fourbi mais suis incapable de la retrouver avec un mot-clé.
Peut-être que vous ne me croirez pas mais il a suffi que j’écrive la phrase qui précède pour que ma mémoire me balance : raisiné ! Hé oui, j’ai écrit le 13 janvier 2006 une chronique sur le raisiné. Qu’est-ce donc le raisiné me direz-vous ? La réponse est là http://www.berthomeau.com/article-1589649.html et par la même occasion vous saurez tout sur les galettes de blé noir de mémé Marie.
Mais je suis trop bon avec vous, en voilà une lichette : « Au temps des bancs de l'école primaire je revenais déjeuner à la maison avec un camarade de classe, René Raymondeau, qui lui habitait une métairie : la Célinière, à plusieurs kilomètres du bourg. Mon frère et ma sœur sont nés à la Célinière, ferme dont mon grand-père avait été le métayer du vicomte de la Lézardière. Dans mon bocage confit dans la religion le vendredi était maigre et, les vendredis d'hiver au déjeuner le menu c'était : galettes de blé noir.
Le blé noir, le sarrasin, lorsqu'on le battait on se serait cru plongé dans le pot au noir : la balle collait aux narines et s'infiltrait sous les vêtements. Les vendredis donc, mémé Marie, aux fourneaux, face à sa galétière entamait son marathon. Elle cuisait ses galettes au beurre de pot, un beurre salé conservé dans des pots de grès, dont la pointe d'aigreur donnait aux galettes un goût incomparable.
Nous en mangions 6 ou 7 nature sauf la dernière que nous enduisions de raisiné.
Voilà, j’en suis là, trop d’IGP noie l’IGP, ainsi la zone de production du cochon IGP Jambon de Bayonne remonte jusqu’à ma vieille Vendée, alors un de ces quatre je vais demander que soit protégé le « luma de Vendée » au nom de mes souvenirs d’enfance. C’est une chanson :
« Quand’qu’te ’m’fais d’la sauce aux lumas Qu’y entends tchieu là qui jargottent Y’t big’rai su les 2 jottes Y sé ben bénèze dans ma piat
Ben tranquillement y tremp’ dans l’piat Dejhà fini faut qu’ te m’ redoune S’tu savais coumme t’es megnoune Quanq qu’ te’m fais d’la sauces aux lumas »
Dépis longtemps y’étais malade O fi sé fai v’nir l’ m’decin Tchiau gars m’défendit la salade La soupe grasse et pis les boudins S’ y avais pris tout’s ces salop’ries O y a longtemps qu ’y s’rais padzit Moué, pour guéri la maladie Un jour, savez-vous c’qui fésis ? Au p’tit déjouna, quatre-vints lumas Et cinq à six verres de noa.»
Deux vidéos : la 1ière très amateur et courte, la 2ième véritable petit documentaire ethnographique du Marais Poitevin de 17 mn à voir absolument et pas seulement pour le litron d’oberlin...
La sauce aux LUMAS
envoyé par originalstick. - Regardez des vidéos d'animaux mignons.







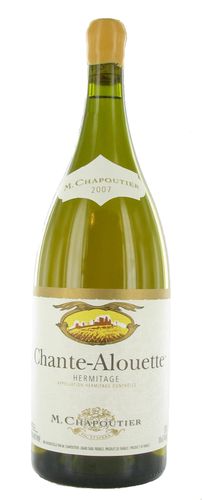











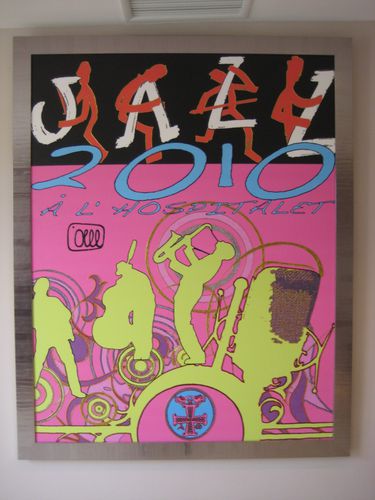




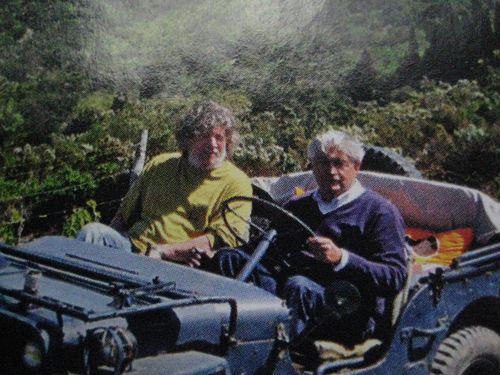
/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)